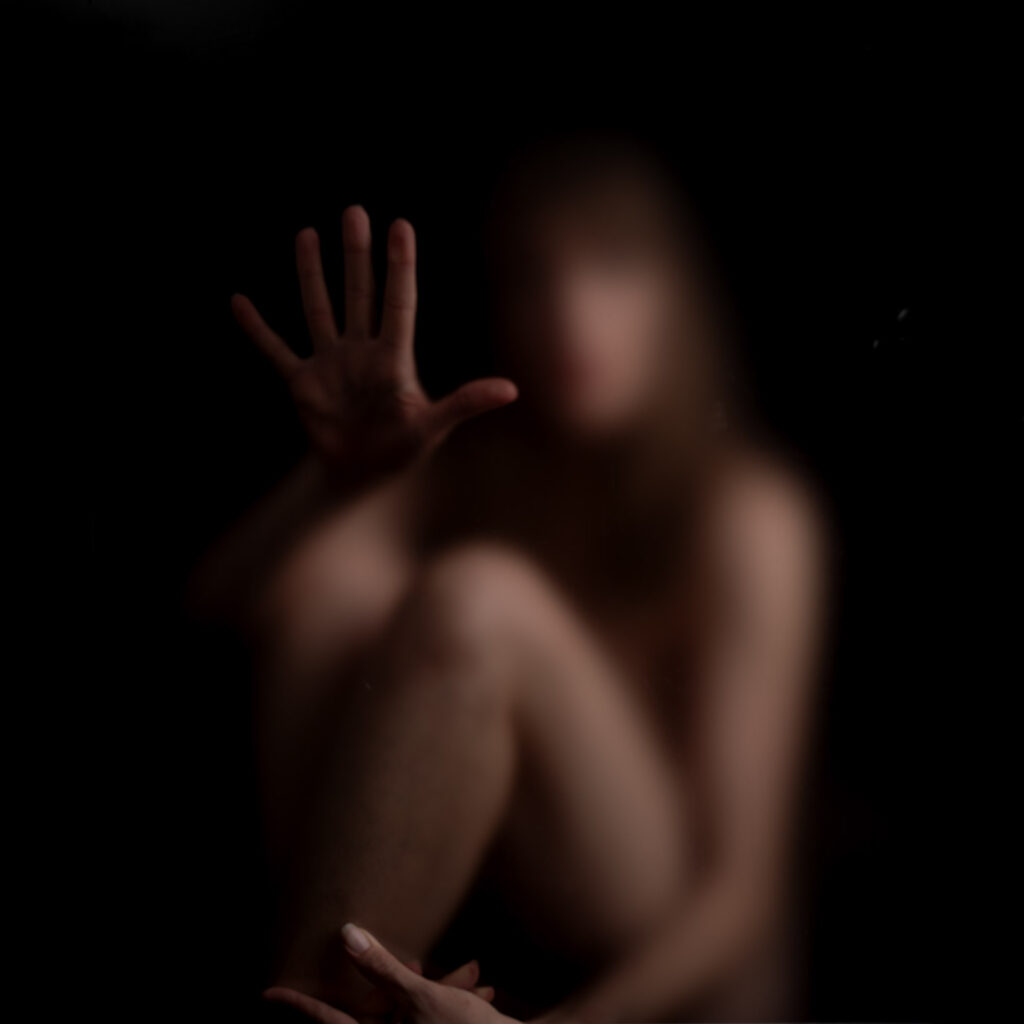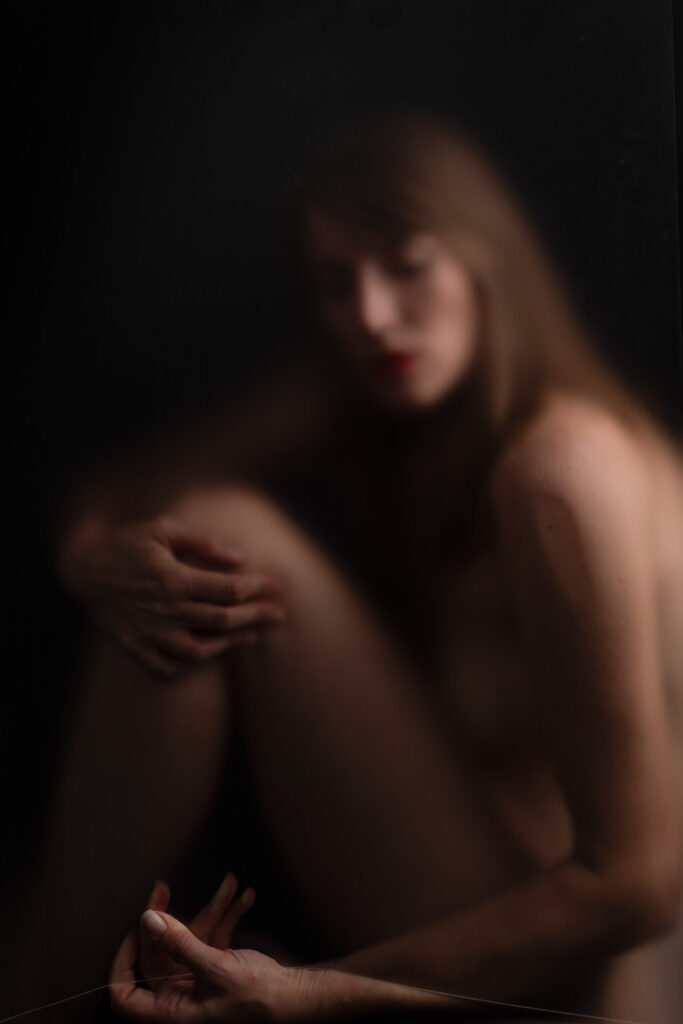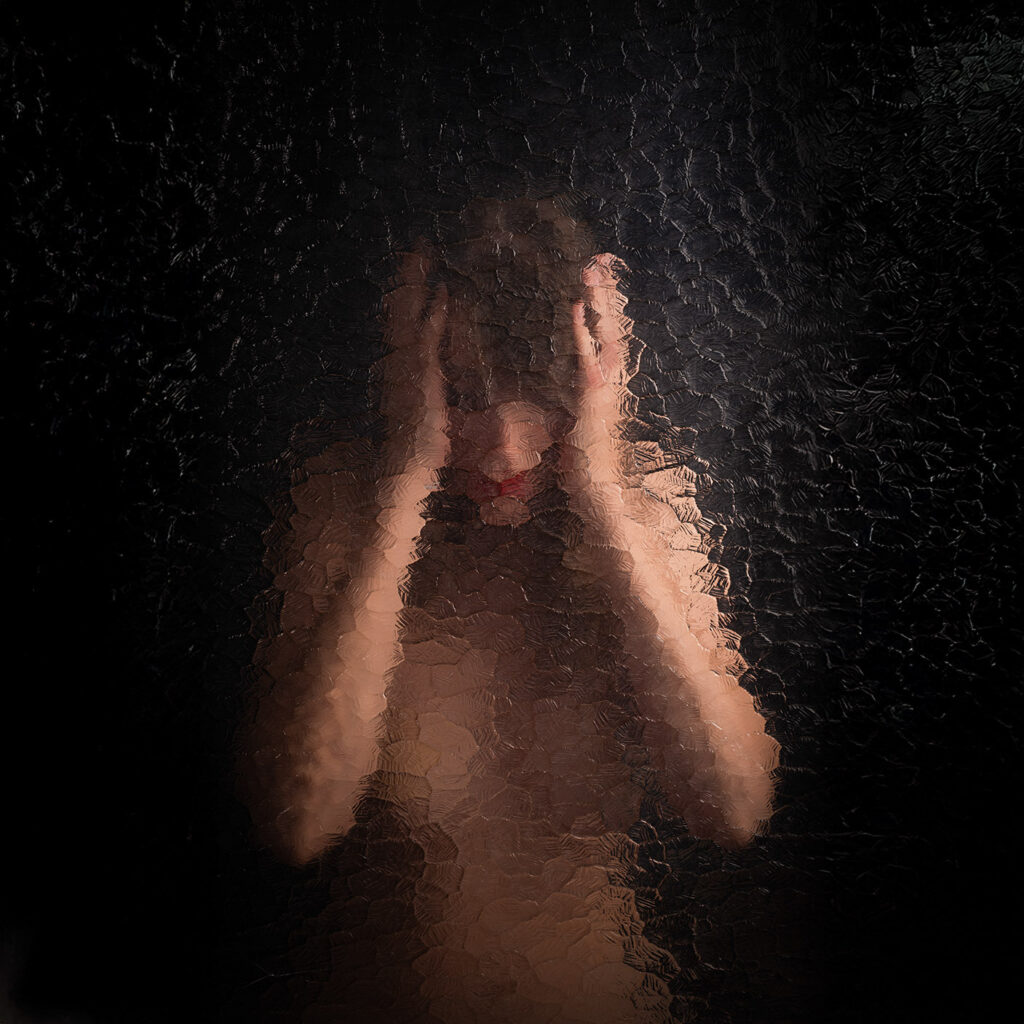« Quand on y pense, la transparence ne peut se définir que par son contraire, l’opacité, de même que le vide, dans l’excellent livre d’Etienne Klein « Ce qui est sans être tout à fait », n’existe que par rapport au plein.
La transparence ne peut donc jamais être totale, comme le vide, faute de quoi elle ne serait que la vision nue et claire du modèle. La transparence, paradoxalement, dissimule toujours quelque chose. Il suffit de se référer par exemple à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont le nom même ressemble à un oxymore et dont le rôle, précisément, est de débusquer les fraudes cachées.
Il y a donc des degrés de transparence, un éventail qui commence juste après la pose du filtre et se termine avec l’obturation totale de l’objectif. Voilà donc le point de rencontre entre le regard du photographe et son modèle, dans ce jeu de cache-cache entre le vu et le deviné, le compris et l’imaginé, l’ombre et la lumière.
Le modèle devient, au sens propre, « l’obscur objet du désir », pour reprendre le titre du film de Bunuel, à jamais obscur parce qu’inatteignable à travers sa transparence trompeuse.
C’est là le paradoxe insoluble et génial de cette approche photographique. L’image ne donne plus à voir, mais à fantasmer. Mais n’est-ce pas au fond le propre de toute oeuvre d’art ?»